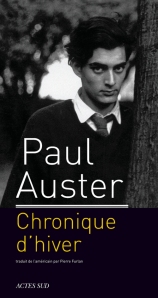Paul Auster a soixante-six ans
Nouvelle preuve que les années 90 sont bien finies : Paul Auster a soixante-six ans. Voilà la première chose qui m’a frappée en lisant sa Chronique d’hiver. Je me suis bêtement dit, oh ben ça alors ! Je le croyais plus jeune. Je le voyais éternellement flâner dans des librairies, un petit cigare à la bouche, courir les dîners et les lectures, écrire tranquilou l’été dans sa maison du Vermont avec sa vieille machine à écrire. Je me rassure : c’est ce qu’il fait toujours, mais il ajoute cette remarque : « Un pull le matin, même par les jours les plus chauds ».
Oui. Paul Auster fait lui aussi des remarques de vieux. Il n’oublie pas son petit pull le matin quand il prend le frais sur sa terrasse. Peut-être dit-il aussi devant son bacon et ses oeufs du petit-déjeuner : « Il fait frisquet, hein? » à son épouse Siri Hustvedt (cette femme admirable dont je me suis parfois dit « je trouve qu’elle est meilleure que lui », comme s’il fallait comparer les couples d’écrivains).
La nouvelle du jour, c’est donc qu’en 2017, quand nous élirons notre nouveau président de la République, Paul Auster aura soixante-dix ans.
Une fois cela dit, quelle vieille personne devient-il ? Je dois avouer qu’il m’est fort sympathique. Il médite sur son corps, qui est doucement en train de le lâcher. Il râle sur le fait qu’avant on pouvait fumer partout, sur les balcons des cinémas, dans les taxis, les salles d’attente des médecins et les librairies, et que maintenant, plus du tout, et que ça c’est chiant, tout de même, à la fin. Il parle de son accident de voiture où il a failli tuer toute sa famille (en fait, même le chien s’en est sorti). Il raconte sa première crise de panique, due à un excès de café, d’alcool et de nuits trop courtes. Il se souvient de la mort brutale de sa mère, le lendemain après l’avoir eue au téléphone pour la dernière fois ; elle lui avait semblé en pleine forme. Dans des pages haletantes, il évoque enfin l’arête de flétan qui s’est coincée dans sa gorge en 1971 et qui a bien failli tuer dans l’oeuf sa carrière littéraire (entre huit et dix centimètres de long !).
66 ans : l’heure du bilan. Après avoir décrit ses petites amies et épouses successives, les putes de la rue Saint-Denis dont la belle Sandra, ses logements dans l’ordre chronologique (avec en creux une intéressante analyse de l’évolution des prix de l’immobilier new-yorkais entre 1962 et 2011), Paul Auster se dit que c’est probablement dans sa grande maison de Brooklyn qu’on enlèvera son corps, à la fin.
La fin. Cette chronique d’hiver, c’est bien entendu l’entrée dans la vieillesse. La mort. Le corps, encore. Prenons ses mains. Ces mains austériennes qui ont tapé à la machine à écrire, rédigé dix-huit romans, des tonnes d’essais, des fantaisies avec Sophie Calle, et des scénarios de films un peu chiants, qu’ont-elles fait ces mains-là ?
C’est une litanie de choses anodines, qu’il énumère en s’adressant à lui-même. « Ouvrir et fermer des portes », « passer ta carte de métro dans le portillon d’accès », « actionner la chasse des W.C », « ouvrir des boîtes de thé », « te gratter les fesses« . Il en profite pour raconter une anecdote drôle sur James Joyce. Imaginez une soirée comme une autre, il y quatre-vingt cinq ans. Une dame, fan d’Ulysse – déjà à l’époque, tout le monde faisait semblant de l’avoir lu -, demande si elle peut serrer la main de l’homme qui a écrit ce chef-d’oeuvre. Hé bien, au lieu de s’exécuter, Joyce répond (quel pervers) : « Permettez-moi de vous rappeler, madame, que cette main a fait aussi bien d’autres choses ». Et Paul Auster d’imaginer Joyce triturant le fion de Nora et se masturbant la nuit, Joyce s’éclatant un gros bouton d’acné devant son miroir, Joyce ôtant le cérumen de son oreille de génie du XXème siècle.
Allons plus loin, c’est-à-dire dans le trivial, mais sans cette crudité provocatrice : imaginons que Joyce s’est déjà battu avec un bout de scotch collé sur le doigt. Abyssal, n’est-ce-pas ? C’est le même sentiment qui nous étreint lorsqu’on lit cette Chronique d’hiver. On se dit qu’après-demain, en montant dans le métro, une pensée idiote et vaguement polluante nous frappera l’imagination, du genre « mince, le sous-sol de l’immeuble a l’air un peu inondé, faudrait que j’en parle à la copro ». Et là nous nous dirons : « Tiens, je connais quelqu’un à qui c’est arrivé il y a pas longtemps ». On cherchera longuement pendant que les stations défilent, on se frottera le menton, on froncera les sourcils, on se dira, putain, c’est qui, déjà ? Réponse : Paul Auster, page 119.
Il arrive également que Paul Auster fasse des insomnies, et dans ces cas-là il part dormir sur le canapé. Mais parfois aussi son sommeil est interrompu par d’autres gens, par exemple Siri Hustvedt. Cette femme admirable a en effet tendance à « lancer ses bras devant elle quand elle se retourne dans le lit ». Et je ne parle pas des moustiques et des mouches, l’été – vous avez, cette saison où l’on n’oublie pas son petit pull quand on prend le frais sur sa terrasse du Vermont.
Une dernière chose : j’ai été frappée, je dois l’avouer, de découvrir à quel point Paul Auster, cet homme si mince, a énormément mangé et bu dans sa vie. La liste de ses aliments favoris est politiquement très incorrecte : Coca, 7Up, milk-shakes au chocolat, Rice Crispies, pancakes au sirop d’érable, soupe à la tomate Campbell’s, poulet rôti, foie sauté, épis de maïs, esquimaux, Oreos. Des fois, quand il se trouve à l’aéroport pour acheter le New York Times avant de prendre l’avion, il s’achète des Chuckles au Relay H (ou équivalent), et il mange les cinq bonbons gélifiés. D’un coup. « Le rouge, le jaune, le vert, l’orange, le noir ». Il ne sait pas pourquoi il ne fait ça que dans les aéroports. Il y a des choses qui ne s’expliquent pas.
Je suis troublée. J’ai toujours cru que Paul Auster était un jeune homme longiligne au regard embrasé, mystérieux comme sur la couverture de ce livre. Je le voyais comme un homme éthéré qui écrit à la machine, dans un espace-temps qui ne m’appartient pas, celui d’une New York fantasmée et irréelle, avec ce temps qui passe mais qui n’existe pas, en vrai. Je découvre aujourd’hui, avec un pincement absurde au coeur, que tout cela est faux. Paul Auster n’est pas comme ses livres. Il a soixante-six ans, et c’est un homme vieillissant comme les autres. L’intimité des artistes, la dernière porte à franchir ? Trop bizarre.
En plus, il a exactement l’âge de mon père.
Chronique d’hiver, de Paul Auster. Actes Sud. Traduit de l’anglais par Pierre Furlan. 22 euros 50.